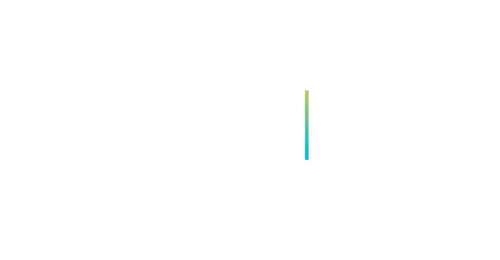Compte rendu : conférence « Recherche insouciance désespérément... »
ISABELLE BARTH accueille l'ensemble des participants ainsi que le public et pose le cadre du débat de cette table ronde : la vocation de chercheurs de repérer des signaux faibles dans la société, de les analyser et de livrer des clés de décryptage de ces phénomènes. Le souci fait partie de nos vies, l'insouciance également et l'un comme l'autre depuis des siècles mais les formes contemporaines de travail et leurs mutations rapides amènent à modifier leur prise en compte. L'objectif est d'ouvrir le débat, de provoquer des questionnements, de susciter des pistes de réflexion, pas d'apporter de réponses et encore moins des « solutions » ou des « best practices ». Chaque participant va faire un point de ses recherches sur ces thèmes, ensuite place sera faite aux échanges avec la salle.
Isabelle BARTH :
Nous sommes donc dans une société où les individus sont sous le regard de l'Autre, des autres, et tout particulièrement dans l'entreprise, sous le regard du client et des collègues. Nous observons trois phénomènes récents qui accentuent ce fait :
- le dogme de la transparence,
- la multiplication des outils de surveillance (caméras video),
- La démocratisation d'Internet,
- L'intrusion dans l'intimité,
Tout ce la nous mène à être en situation de comparaison permanente, qui se fait presque toujours à notre désavantage tant les critères sont devenus inaccessibles (par exemple : se comparer avec les 8 plus beaux top models en matière de beauté). Nous avons le sentiment, bien souvent d'évoluer dans une société du mépris (Honneth, 2006) Ce sentiment va de pair avec :
- Une montée en puissance de l'individualisme (rejet ou perte des repères)
- Le culte de la performance, de la réussite dans tous les domaines (professionnel amis aussi personnel : il faut réussir ses vacances, et garder un corps en pleine forme)
- Un besoin de reconnaissance de plus en plus exacerbé (Caillé et al., 2008)
Ceci génère de la souffrance, et pour continuer à vivre, nous mettons en place des stratégies de résistances. Deux types de résistances sont souvent retenus et étudiés :
- la résistance active : qui se traduit par l'opposition avec des actes de rébellion, des manifestations, des grèves ...
- la résistance passive, souvent silencieuse qui se retrouve dans le désengagement, la désimplication
Nous pensons qu'il existe une troisième voie, peu repérée : celle qui consiste à rechercher l'insouciance. Nous allons voir que cette insouciance peut prendre des formes très diverses, et pas toujours très positives, car l'insouciance peut être un refuge, elle peut être une fuite .... L'insouciance heureuse est celle de l'enfance, admettons que nous recherchons désespérément à la retrouver et que c'est là une quête infinie de nos vies d'adulte encombrées de soucis.
Michel VALLÉE :
Comme consultant en changements organisationnels, et spécialiste des signes et troubles psychosociaux, je rappelle que selon les enquêtes, c'est 30 à 70 % de la population qui est touchée par le stress. On a pu constater une certaine reconnaissance du phénomène avec la parution de l'ouvrage sur le harcèlement de MF H en 1995.
Il faut bien comprendre que si le stress est reconnu comme maladie professionnelle : tout s'arrête, les médecins du travail deviendraient fous ! La prise en charge s'écroulerait car il ne serait possible de ne procéder à une visite que tous les 5 ans.
Il faut aussi dire qu'après une période où tout conflit a été pris pour du harcèlement, on prend du recul et on est à même de mener des analyses plus objectives.
Les contextes de travail favorisent les pathologies au travail, quelques observations simples :
- les cadres sont dépassés par les contradictions à gérer, et ceci atteint de plus en plus les cadres supérieurs,
- les collectifs de travail sont dilués, on gère les personnes à distance sans jamais les regarder dans les yeux,
- les suicides que l'on peut lier aux contextes de travail sont actuellement en croissance
- Je rappelle que ces éléments qui peuvent sembler subjectifs sont objectivables et que l'accès aux données peut se faire en ligne sur des sites comme : ....... Il est urgent de repositionner les relations sociales et de repenser les modèles de management en entreprise car les rapports sont unanimes pour montrer qu'il y a une dégradation continue avec un impact direct et lourd sur les troubles psycho-sociaux.
Dominique DRILLON :
L'IPM (Institut Psychanalyse & Management) a vu le jour à Rennes en 1990, au cours d'une journée de recherche qui avait réuni des managers, des chercheurs en gestion et des psychanalystes et psychologues. Ce projet était fondé sur le constat que managers et psy pouvaient contribuer conjointement au renouvellement des pratiques de management, même si tout sépare leurs approches.
La psychanalyse et le management sont tous deux des pratiques et des objets de science et peuvent proposer un double regard très riche. C'est ce que montre le succès des colloques annuels de l'IP&M, le dernier a eu lieu à Lyon en février 2007 et le prochain se tiendra à Nice les 28 et 29 Mai prochains.
La psychanalyse introduit la notion d'inconscient qui va mettre en scène les pulsions de vie et de mort des hommes et des femmes, et permettre de relire des phénomènes comme le burn out et le karachi.
Dans ce cadre, l'insouciance serait une manière d'échapper à l'insupportable.
L'évolution de la société avec la place croissante des medias, de la télévision, la publicité, les jeux vidéo ... l'effacement du rôle des parents remplacés par des personnalités éloignées et éphémères ont généré ce qu'on peut appeler l' « hyper ego », qui va troubler le « moi », et produire des comportements excessivement impulsifs, plus tournés vers l'action immédiate et non réfléchie...
Par ailleurs, la pression, avec la disparition des collectifs est vécue de façon de plus en plus individuelle et augmente le sentiment de « souci permanent ». L'insouciance peut alors peut être analysée comme une fuite, un symptôme ou également comme un mécanisme de défense. Dans ce dernier cas, elle est un « masque ».
Renaud MULLER :
Nous sommes dans une culture qui a survalorisé la maîtrise de soi, nous sommes de plus en plus dans une mise en scène d'un détachement des contraintes (comme le dit Legendre).
Se pose la question de savoir comment s'organise ce que les anthropologues ont appelé la loi. On observe que s'y est substituée l'image car nous sommes entrés dans la conformité visuelle. Les repères ne se définissent plus de façon traditionnelle.
On a assisté dans les années 60 à un fort rejet des contraintes. L'insouciance était alors une insouciance de rejet. Rejet de pratiques de management conçues comme participatives, rejet du travail épanouissant ou encore de la réussite comme un défi. Cette insouciance est alors récupérée par le management. Mais une fois que cette insouciance est devenue la norme : comment se différencier ? Il faut alors redoubler d'efforts pour paraître encore plus cool.
Concomitamment, nous assistons à une évolution des modes de contrôle, qui deviennent plus doux, plus insidieux. Nous vivons avec une idéologie de l'action immédiate, du changement : il faut être prêt à changer tout le temps. Les modes de contrôle sont de plus en plus gérés par la technologie. Nous évoluons entre la peur et l'hyper contrôle.
Un travail mené avec ISABELLE BARTH nous a permis d'identifier 4 types d'insouciance :
- l'insouciance inconsciente
- l'insouciance défensive
- l'insouciance refoulée avec son cortège d'actes manqués
- L'insouciance d'espoir, raisonnée, celle qui permet le lâcher prise , pour se ressourcer, pour retrouver un peu d'intimité, dans les open spaces, ou dans le travail en équipe pour résister au contrôle social.
Il faudrait former les managers à différencier les postures, il faut requestionner les contraintes implicites et les aider à sortir de la double contrainte animer et séduire.
Pauline FATIEN :
Isabelle BARTH :
- Le narcissisme : admiration exagérée de soi même, de son apparence (en phase avec le culte de la personnalité)
- Le détachement ironique : stratagème pour dissimuler des sentiments (s'inventer une personnalité, se fabriquer un masque de sérénité)
- L'hédonisme : jusqu'à l'auto-destruction (comme dans le cas de l'addiction par la drogue, ou de défi avec la mort ...)
Le Cool, c'est aussi le rejet des sentiments et des émotions négatives : la colère des parents, la ferveur patriotique, l'indignation morale ... et le mépris des tabous de la société. Ce qui domine dans le Cool, c'est l'enjeu de l'apparence où l'on retrouve cette importance du regard des autres. La grande question est de décréter ce qui est cool, ce qui inscrit dans une forme d'autoévaluation permanente, d'ajustement constant pour le choix des pairs. Qui est cool ? qui ne lest pas ? Ce qui conduit à une extrême dépendance vis-à-vis des autres sur sa dimension « cool ». La personne qui se veut cool est condamnée à une course sans fin.
Le Marketing a bien compris tout cela et a entamé une vaste « récupération » de ces aspirations, tellement en phase avec la société de consommation. Il propose de nombreux produits et services qui peuvent répondre ou qui prétendent répondre à ce besoin de coolitude/d'insouciance.
Nous pouvons ainsi identifier 4 types de promesse :
- la recherche de l'ailleurs, la promesse de s'arracher au quotidien avec les voyages, le tourisme
- le retour dans le passé, la nostalgie de l'enfance
- la bulle, la parenthèse enchantée, l'instant radieux (le i pod, le téléphone portable, les jeux vidéos,
- les « aidants » (l'installation de services de conciergerie ou de crèche en entreprises ...), les briseurs de soucis : le Spas, l'alcool
- mais le marketing ne va-t-il pas trop loin parfois ?
Avec des offres « trop cool » : on peut ainsi citer : le crédit par SMS (qui a fait de jeunes insouciants une génération s'interdits bancaires en Suède), la location de ce qui autrefois était impliquant (on trouve des offres de location de chiens), ou encore le culte des morts rendu par procuration ?
Le consommateur est souvent très en avance sur le producteur et le marketing précède souvent le monde du travail. C'est peut être en observant ces signaux faibles les en consommation que nous pouvons ensemble réfléchir au traitement de l'insouciance en management.
Débat avec la salle
QUESTION : Pourriez vous revenir sur l'uniformisation des attitudes et des comportements, cette peur du regard des autres qui empêche d'être soi-même ?
RENAUD MULLER : Ce que nous pouvons retenir, c'est que le rejet des contraintes en génère d'autres, souvent plus pernicieuses, l'intimité doit être réhabilitée
MICHEL VALLÉE : Les demandes de normalisation pèsent sur l'émotionnel, c'est tout l'enjeu de la reconnaissance sans obligation ni d'être pareil ni d'être différent.
DOMINIQUE DRILLON : Se pose la question des nouveaux modes de management : j'ai récemment rencontré un chef d'entreprise qui manage 3800 personnes à travers le monde uniquement à distance, sans jamais les rencontrer. Cette situation interpelle la reconnaissance mais aussi l'intrication vie personnelle/vie professionnelle, quand on est en home office, c'est là que les situations de burn out se posent de façon aigue.
QUESTION : J'aurais souhaité que vous alliez plus loin, mon expérience me fait dire que la performance d'une entreprise est proportionnelle au degré d'insouciance des dirigeants et des salariés...
ISABELLE BARTH : Votre remarque appelle deux types de réponses : - nous n'avons pas voulu traiter l'insouciance uniquement dans sa définition la plus immédiate mais bien explorer toutes les facettes d'un phénomène complexe, que nous considérons comme un symptôme important de nos sociétés contemporaines - elle pose aussi la question du rôle du chercheur : notre posture n'était pas d'apporter des réponses ou des « solutions » clés en main, mais bien d'amener à réfléchir.
Sur le fond : j'ai beaucoup travaillé sur l'humour qui est également fondé sur cette prise de distance avec des situations vécues comme stressantes (l'humour noir en est emblématique), la question est que l'humour comme l'insouciance ne peuvent devenir la norme. Sinon, ils se diluent et soumettent les personnes à des doubles injonctions : « sois drôle ! », « sois insouciant ».
QUESTION : Quelle serait l'avenir de l'insouciance dans l'entreprise
RENAUD MULLER : Elle nous amène à une meilleure prise en compte de l'intime, sortir des modèles dominants qui ne sont fondés que sur une logique de contrôle pour faire valoir le besoin d'un quant à soi
QUESTION : Quand vous décrivez les entreprises qui « récupèrent » l'insouciance avec des offres de conciergerie, crèches en entreprise etc .. est ce que ce n'est pas du néo-paternalisme ?
PAULINE FATIEN : Je ne crois pas, car la figure du père s'est effacée au profit du « système de gestion »
ISABELLE BARTH : Je ne le crois pas non plus, car le rapport à l'entreprise a évolué et le salarié lui-même à instrumentalisé l'entreprise, ce qui n'était pas le cas dans le paternalisme
QUESTION : Qu'enseigne-t-on aux étudiants sur ces sujets ?
ISABELLE BARTH : Pas grand-chose, il est frappant de voir comment l'enseignement en mangement est formaté et se cantonne aux bonnes pratiques ... du passé ! Nous avons un devoir d'innovation que nous n'exerçons pas.
QUESTION : Peut-on revendiquer ce droit à l'insouciance dans les entreprises ?, comme une façon de pouvoir respirer ?
TABLE RONDE : oui ! Trois fois oui !